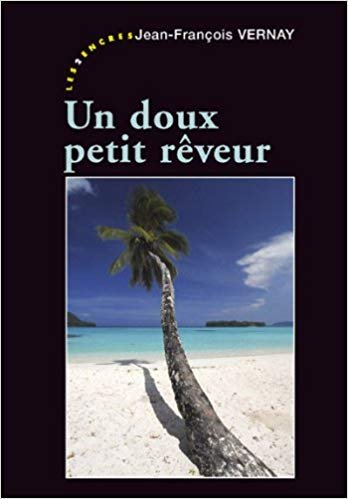Classer Un doux petit Rêveur de Jean-François Vernay parmi la littérature calédonienne serait à la fois très logique et très injuste. Très logique, parce que non seulement son auteur est lui-même calédonien de naissance, mais aussi et surtout parce que l’île fictionnelle où l’action a élu domicile fleure bon le niaouli et les flamboyants. Mais très injuste pourtant, parce que c’est faire de lui un nouvel avatar exotique, le genre de petit ouvrage que l’on s’offre quand on ne peut pas partir en vacances. Oui, très injuste parce que ce livre est bien plus que cela, tout sauf cela. C’est pourquoi je ne m’attacherai pas à faire l’éloge du magnifique décor, de sa puissance évocatrice, de son charme insulaire, même si tout cela aussi peut être invoqué à son égard. Je voudrais plutôt mettre en lumière l’extraordinaire et paradoxale épaisseur de ce livre trompeusement léger et qui se révèle à la lecture d’une densité étonnante, proprement poétique. Et c’est sous cet aspect que je souhaite maintenant analyser ce récit.

- Jean François Vernay
- Ph : Eric Dell’Erba
Dès son seuil—ou plutôt devrais-je parler de seuils au pluriel—cet ouvrage nous propose une enfilade de portes, de sas à passer qui auraient pu en figer la réception dans une direction unique mais qui sont en réalité autant d’itinéraires de significations possibles par lesquels le texte nous invite à passer : le premier exergue place le récit dans un contexte social et met ainsi en évidence une relation possible de cette fiction au monde réel. Le second, sous le patronage de Jorge Luis Borges, interroge également cette frontière entre deux mondes qui peut trouver sa réalisation dans le rêve. Il nous invite donc à repenser ce passage réel/fiction comme une porte ouverte sur notre subconscient. La préface, enfin, non signée mais clairement parole de l’auteur, nous tend un miroir et nous invite à une lecture réflexive, qui questionne aussi bien l’identité et le statut du personnage que ceux du lecteur.
Trois portes donc, trois entrées qui prennent en compte les trois états de l’être, conscience sociale, conscience onirique et conscience identitaire, qui chacune à leur manière permettent l’entrée en littérature. L’auteur noue donc dès le début un contrat avec son lecteur, celui d’un feuilletage énonciatif, aussi bien en ce qui concerne la réception du message qu’en ce qui concerne son/ses énonciateur(s).
Entretenir la polyphonie, ce récit s’y attache de manière évidente : outre un narrateur omniscient mais qui, au fil du récit, va faire aveu d’impuissance, se mêlent des voix aussi étonnantes que celles d’un chat polyglotte—qui met en abîme au sein même du récit cette notion de polyphonie car il dévore au sens littéral du terme les langues des touristes imprudents—d’une souris hydrophobe, d’un escargot philosophe, d’un insaisissable personnage du nom de Fil lequel mange les mots plutôt que les langues, ou encore celle du petit héros Benjamin, auxquelles s’ajoutent bien sûr tous les échos périphériques des diverses préfaces et postfaces déjà évoquées. Au fond, se pose d’emblée la question du « qui parle ? ».
Construit en trois parties, le récit s’ouvre sur un mode de narration très classique, avec un narrateur omniscient et effacé dans la plus belle tradition naturaliste. Mais cet académisme énonciatif se révèle très vite trompeur puisque les commentaires du narrateur vont aller en s’intensifiant tout au long du livre, jusqu’à mettre au jour un narrateur intradiégétique dans la dernière partie de l’ouvrage. Il confie alors ses incertitudes sur le récit qui débouchent sur un doute rétrospectif du lecteur concernant la fiabilité de tout ce qui précède. Puis cette instabilité est encore renforcée par un retour au style indirect libre, focalisé sur le jeune héros Benjamin, et qui rend au narrateur ses pleins pouvoirs. Il est donc clair que, sur ce point l’instabilité est de mise.
Par ailleurs, à l’image de ce narrateur alternatif, les personnages eux-mêmes sont tous placés dans un décalage face à la norme et dans un questionnement identitaire : le monde dans lequel ils évoluent ressemble à celui de l’enfance entre rêve et réalité, les animaux y parlent, comme des humains, et parfois, on l’a dit, plusieurs langues, les végétaux, animalisés, y ont des intentions propres comme le Banian Constrictor ou la Datura Diabolica—délicieusement nommée—et les êtres prétendument humains eux aussi, comme Benjamin et Fil ne sont plus très sûrs de leur statut, démiurges ou prisonniers de ce monde : les règnes se mélangent et glissent les uns vers les autres. Dans ce décor Benjamin et Fil exercent tour à tour leurs pouvoirs, notamment à travers le jeu de la « forteresse vide » qui consiste à effacer les éléments du milieu jusqu’à faire place nette, puis se heurtent aux limites étroites du lieu. Incertains de leur environnement qui s’enfle à la mesure de leur désir pour se refermer sur eux à en étouffer, à l’image de ce banian constrictor, les deux personnages principaux s’interrogent aussi sur leur degré de réalité propre. Serait-il possible de s’effacer soi-même ? C’est en tout cas la réponse finale du récit, mystérieusement, Fil disparaît au cours de l’antépénultième chapitre, alors que Benjamin « s’évanouit »—bien noter la polysémie ambiguë du terme !—à la dernière ligne. Cette incertitude face à sa propre réalité donne lieu à une ambiguïté encore plus forte quant au statut de chaque personnage.

- Jean François Vernay
- Ph : Aimablement prêtée par J.F.V
En effet, la seconde partie, majoritairement centrée sur l’énigmatique Fil, fait vaciller le récit en sous-entendant la possibilité que Benjamin ne soit qu’une émanation de l’imagination hautement littéraire de ce personnage dont la lecture préférée est justement ce roman que nous lisons… vertige. Mais Fil lui-même n’est-il pas aussi création imaginaire de Benjamin, lorsqu’il l’évoque et le matérialise à ses côtés à tout moment lorsqu’il le souhaite et le fait disparaître à sa guise ? D’ailleurs si l’on considère son régime alimentaire, le petit homme, qui selon l’adage devrait être ce qu’il mange, n’est alors qu’un être de mots. Ainsi aspirés, l’un et l’autre, dans leurs univers respectifs, ils figurent à la fois l’écrivain et sa création, dans une sorte de double entité très indéfinie. Le narrateur lui-même dans l’avant-dernier chapitre cède à ce vertige et cette aspiration et a « le sentiment de [s)e regarder dans le papier », comme dans un trou noir, qui ferait écho au puits aux merveilles mystérieusement asséché de ce monde onirique, étrange vortex qui entraîne également le lecteur dans son incertitude existentielle.
Malmené, déstabilisé, ce lecteur l’est aussi certainement tout au long du récit, par les allers-retours incessants entre divers niveaux énonciatifs, lesquels créent également une incertitude générique : roman, nouvelle, conte philosophique, poétique, médical ou simple « texte » ?. Indéniablement, nous sommes ici en présence d’une pièce narrative, et l’on peut en retracer les contours : Benjamin, petit métis enfermé dans une institution isolée sur la « presqu’île de l’Oubli » et dans son monde intérieur tente de survivre à ses différences et de peupler son univers. De plus en plus meurtri, peu à peu vidé de sa force d’évocation, il finit par tenter l’entrée en littérature, acte créatif ultime dont on ne saura jamais vraiment s’il a été salvateur ou destructeur. Peu référencés, peu caractérisés, les lieux et personnages évoquent l’exténuation du roman moderne, simple support d’une écriture qui se veut finalement son propre objet.
A distance de ce niveau énonciatif fondamental, un autre discours se présente, ponctuellement, et par la voix du narrateur commente le déroulement du récit : tantôt ironique, par exemple lorsqu’il fait allusion à la piètre qualité orthographique du petit héros, tantôt interrogateur quant aux réelles motivations qui animent les différents personnages, tantôt explicatif pour, en complicité avec son lecteur, fournir quelques éclairages historiques inconnus des protagonistes. Ces incartades offrent la possibilité de contempler de plus haut le déroulement du récit et les évolutions des personnages, mais ne sont en réalité qu’illusion de la maîtrise et de la distanciation laquelle finalement ne fait que renforcer le sentiment général d’instabilité.
C’est que le livre lui-même est à plusieurs reprises aspiré, mis en abîme dans son propre récit : lorsque Fil avoue montrer une préférence pour l’histoire qui débute par « [a]ssis sur un éboulis… » et qui constitue justement l’incipit de notre roman, et qui, comme par hasard, contient les mots-mêmes que Fil adore, comme « gymnopédie » ou « polyglotte » ; puis au cinquième chapitre de la dernière partie, lorsque le narrateur, mis en scène dans son action d’écriture, évoque la fin prochaine de son propre livre « à quelques paragraphes de la fin ». Au-delà du brouillage générique on pourra aussi parler de brouillage des frontières entre monde réel et fiction, lequel parachève l’entreprise de dynamitage des certitudes. Cet entre-deux littéraire est d’ailleurs renforcé par le choix des lieux, parfaitement fictifs et pourtant totalement transparents quoi que renommés : la « presqu’île de l’oubli » est une simple traduction de l’île « Nou », la végétation qui la couvre bien réelle, et l’institut qui s’y est établi historiquement vérifiable. Si l’on y ajoute ce continuum ininterrompu qui va du narrateur à l’auteur par divers stades sans rupture, on pourra affirmer que la frontière est bien difficile à repérer entre notre monde et le monde de papier.
C’est justement dans cet espace libéré que peut se développer la question fondamentale—à mon avis—du récit : c’est-à-dire celle du langage, son rapport à la réalité, sa capacité de création ou de référence, métaphysique proprement wittgensteinienne. A plusieurs reprises, l’esprit particulier des personnages reprend de façon littérale des expressions toutes faites et les matérialise : « donner sa langue au chat » se transforme en un matou polyglotte qui pose des devinettes aux touristes étrangers pour en recueillir le langage, et « se noyer dans un verre d’eau » est pris tellement au sérieux par la souris Mattoïd qu’elle refuse de se désaltérer. Dans le même esprit, Fil se nourrit littéralement de mots, il les mâchonne et les mange, alors que Benjamin donne des couleurs à la vie. Tout fonctionne comme au creux des rêves, lorsque la simple évocation suffit à faire apparaître la chose : ici le mot crée la réalité.
Cependant, littéralement comme métaphoriquement, le récit met aussi en scène une paradoxale dévoration du langage par la fiction : outre Fil le logophage dont nous avons déjà longuement parlé, des paragraphes voire quasiment des pages entières blanches commencent à apparaître dans le livre dès la deuxième partie, comme si effectivement, des mots avaient été dévorés ou effacés dans le jeu de la « forteresse vide », comme si la fiction elle-même avait son mot à dire—ou à enlever—sur l’objet-livre et pouvait agir sur lui.
Partagé donc entre un pouvoir démiurgique et son corollaire destructeur, le langage et la littérature semblent contaminés par l’incertitude fondamentale qui règne dans le récit. Si cette dernière constitue la voie ultime de libération tentée par le jeune héros, la fin abrupte du livre ne nous permet pas de confirmer son efficacité. De la même façon les personnages ne savent pas toujours s’ils ne sont pas finalement habités par ce vide intérieur qui est la caractéristique de l’être de papier, interrogation qui va jusqu’au narrateur lui-même, nous l’avons vu. Là non plus, il n’y a donc pas de réponse franche et c’est peut-être justement la grande force de ce livre que de laisser ouvertes les interprétations, entre enfermement et salvation, exactement comme le petit monde de Benjamin qui s’enfle et se rétracte au gré des pulsations de son imagination. Or en fin de compte, quelle autre définition plus vaste de la poésie que la multiplicité des angles de vue, que l’épaisseur de sens ? Et c’est en cela que ce livre est un petit bijou poétique.
En mettant en scène un/des personnage(s) atteints d’une pathologie bien réelle appelée TED ou encore Trouble Envahissant du Développement, J.F.V. révèle aussi une certaine fonction utilitaire du décalage mental, qui se met au service de l’humanité : questionnement des mots en leur sens littéral, conscience du temps, appropriation de l’espace, créativité,… tant de choses du domaine de l’enfance qui ont été nos attributs, à nous qui apparemment ne sommes victimes d’aucune maladie, à nous qui sommes « normaux » mais qui avons peut-être oublié le goût du fondamental et de l’essentiel. Elle nous pousse à interroger aussi notre rapport au langage et à la création, et jusqu’à notre propre réalité. Qui sommes-nous au fond ? Et comment pouvons-nous être sûrs que nous ne sommes pas, nous aussi, des êtres de papier ?