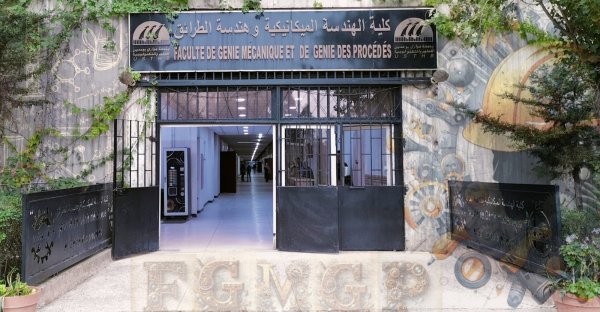« Vouloir le vrai, c’est s’avouer impuissant à le créer. »
Nietzsche, Humain trop humain.
« Depuis l’institutionnalisation de la recherche universitaire au cours du XIXe siècle, la question du lien entre enseignement et recherche refait surface de façon récurrente. » (1) La réalité que cherche tout sujet universitaire ferait le lit d’un capitalisme, accédant à lui-même par lui-même, jamais désigné comme la cause majeure de notre condition humaine et socio-historique, si la pensée de soi n’était pas menée par soi-même. Que peut la réaction politique face à la contre-révolution menée par les anthropologues devenus les idéologues de la régression, laquelle est servie par les modèles conceptuels occidentaux suivis par nos chercheurs qui se comportent comme des élèves disciplinés ? Les savoirs auxquels on accède n’ont jamais pu impacter les matrices de nos champs de recherche. Étrangement, certains enseignants universitaires procèdent, par conservatisme, voire terreur morale, aux diverses opérations liées à la pédagogie et à la conceptualisation.
Ces personnels à court de théories qu’ils devraient pourtant construire avec les diverses altérités auxquelles échoit la fonction d’examiner le savoir ne sont pas prêts à mener leurs tâches selon les standards universels. Certes, il y a des espaces où ces personnels se heurtent à des chercheurs rebelles et convaincus de la crédibilité de leurs approches ; mais, comme il n’y a pas de pensée autonome et comme le conservatisme veille sur les « bonnes manières » et sur « la bienséance », il n’y a pas d’espoir de voir des chercheurs capables de se révolter contre les temples de la pensée conformiste et de dépasser l’ordre établi. L’universel est devenu la propriété des clubs privés (think-tank) du fast-think. Le savoir collectif assure l’autorité de la république et soigne les traumatismes capitalisés par les situations par lesquelles un peuple passe. Les passages historiques, traumatisants et mémoratifs, sont dangereux, en ce sens qu’ils exigent des cumuls énergétiques (moraux et physiques) très lourds pour que la machine existentielle se remette en marche. Daniel Bensaïd écrivit : « On a l’habitude de penser l’engagement comme relevant tout d’abord d’un choix intellectuel. Cette vision classique draine avec elle les vieilles hiérarchies philosophiques entre l’intelligible et le sensible ou l’esprit et le corps. » (2)
Les conservateurs de l’université tiennent une fausse légitimité puisque c’est le contexte socio-historique qui la leur a octroyée car ils n’ont jamais pris position vis-à-vis des questions qui intéressent la collectivité à travers un tracé politique conséquent. Ces universitaires, présentés comme des scientifiques « neutres », sont dans l’analogisme des plus laids et des plus désastreux. Les professeurs ne peuvent se dédouaner de leur moralomanie s’ils n’acceptent pas d’être mis à égalité avec les divers agents historiques de la posture de producteurs de sens. Le contexte postindépendance a permis aux lettrés de garder les us de l’école héritée du colonialisme. Face à cela, le processus de dépersonnalisation se poursuit. Sous le parapluie officiel, les lettrés ont pu prendre le dessus sur les élèves venant des masses populaires. De cela s’est développé un écart profitant à l’abstractionnisme universitaire. Addi Lahouari écrivait : « Coller à l’État, répéter son discours, bâtir les mythes, voilà la ligne de conduite des intellectuels jusqu’aux années quatre-vingt, jusqu’aux émeutes d’octobre 1988 qui leur ont montré que la coupure avec la société était profonde et que l’État démiurge n’est qu’un mythe parmi tant d’autres. » (3)
Cette conséquence a durement impacté les personnels quêteurs de sens dans la mesure où ceux-ci deviennent sujet-objet d’un savoir qu’ils subissent, mais qu’ils ne construisent pas. Cela profite aux idéologies dominantes et celles-ci font le lit de la science capitaliste. Les pouvoirs en place ont laissé faire les courants qu’animaient les universités car celles-ci se limitaient aux débats « techniques » et dépolitisés. Si jamais la posture politique émergeait, il y avait divers courants à la subvertir. On actionne les identitaristes (de diverses origines), les religieux et les groupes vivant sous le diktat de diverses névroses. Les chercheurs font abstraction de tous les sujets qui traversent la société au prétexte qu’il faut éloigner les institutions de savoir de ce que produit la pensée de l’instant. Les officiels s’approprient de la détente intellectuelle pour confondre tout à tout, des espaces scientifiques pour en faire des ghettos ethnoculturels et des cercles intellectuels pour produire et orienter l’opinion publique. Les institutions sont de simples appareils bureaucratiques (au meilleur des cas) qui n’assument pas les tâches qui leur sont échues. « Ne s’encombrant ni d’une constitution ni d’une idéologie, les institutions structurant la grammaire du système autoritaire algérien depuis ses fondations (1954-1962), sont informelles. » (4)
L’espace universitaire n’a pas pu échapper aux officines, en ce sens que les personnels universitaires actifs sont interdits (non par une quelconque loi, mais par un dogme bien compris par tous -disons tacite) de penser les questions fondamentales de l’humain et de l’espace de référence. Par la terreur exercée sur eux, les producteurs de sens ont plafonné leurs réflexions à ce que permettent les appareils répressifs de divers ordres, policiers et civils, bureaucratiques et intellectuels, discursifs ou cursifs, créatifs ou réactifs, etc. L’abstractionnisme, profitant aux décideurs, a achevé la mission accomplie par les nervis de l’idéologie officielle. « L’idéologie unanimiste imposée à la société algérienne a empêché les enseignants-chercheurs de s’épanouir sur le plan social et professionnel. » (5)
Notes bibliographiques
(1) Gingras, Y. (2003). Idées d’universités Enseignement, recherche et innovation. Actes de la recherche en sciences sociales, 148(3), 3-7. https://doi.org/10.3917/arss.148.0003.
(2) Daniel Bensaïd, « Engagement et neutralité du savoir », revue Agone (Marseille), n° 18-19, janvier 1998. Le texte est consultable au lien suivant : http://danielbensaid.org/le-travail-intellectuel-au-risque-de-lengagement/
(3) Addi, Lahouari. « Les intellectuels algériens et la crise de l’État indépendant ». Implication et engagement, édité par Philippe Fritsch, Presses universitaires de Lyon, 2000, https://doi.org/10.4000/books.pul.10089.
(4) Hachemaoui, M. (2016). Qui gouverne (réellement) l’Algérie ? Politique africaine, 142(2), 169-190. https://doi.org/10.3917/polaf.142.0169.
(5) Karim Khaled, “Les retours de l’intelligentsia diasporique algérienne”, Hommes & migrations [Online], 1300 | 2012, Online since 01 November 2014, connection on 09 November 2025. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/915; DOI: https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.915